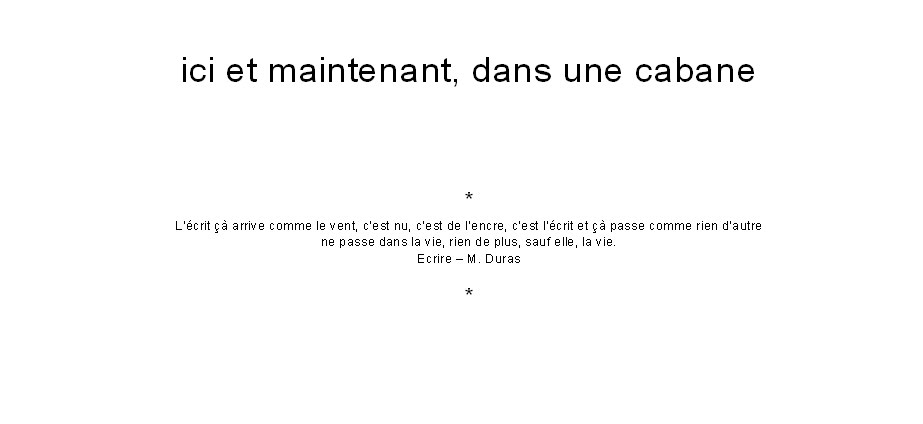*
Début 1954, mon père F. a pris en main une plantation de café de 100 hectares, à 25km de Bocanda... sur la route de Ouellé. On quittait la route de terre rouge latérite, on prenait une piste étroite qui montait à travers les caféiers et débouchait à 300 mètres sur les habitations de la plantation Korékro.
Début 1954, mon père F. a pris en main une plantation de café de 100 hectares, à 25km de Bocanda... sur la route de Ouellé. On quittait la route de terre rouge latérite, on prenait une piste étroite qui montait à travers les caféiers et débouchait à 300 mètres sur les habitations de la plantation Korékro.
A notre installation, mon père dut débroussailler, avec l'aide de manœuvres, les lieux délaissés depuis longtemps. Il récoltait les baies dites cerises, les faisait sécher sur des terrasses de ciment, avant de les décortiquer à l'aide d'une machine sous les hangars et ainsi mettre en sac, les grains de café. La récolte étant insuffisante, il partait avec son camion Renault Galion dans les campements alentours et achetait aux paysans leurs petites productions. Il revendait le tout à de plus importants négociants.

Au cœur de la plantation de café, s'élevaient et s'étendaient notre maison, la boutique, le château d'eau et sa citerne, le poulailler et l'abri des chèvres, les habitations des manœuvres et les hangars pour le café. La boutique, toute petite pièce, était tenue par Touré qui vendait aux paysans des campements, les produits de première nécessité comme le sucre, le savon, les allumettes, des cigarettes à l'unité, de l'huile de palme, des machettes, des lampes tempêtes.
Pour mieux se faire comprendre des paysans avec lesquels F. faisait du petit commerce, il avait appris le baoulé, la langue de l'ethnie Baoulé qui habite les savanes s'étendant entre le fleuve Bandama et le fleuve N'zi. Mon père s'était confectionné un dictionnaire des mots qu'il employait (aujourd'hui disparu dans les nombreux déménagements) Le matin vers 10h, les paysans voisins de la plantation s'asseyaient au milieu de la cour, certains dans l'attente de l'ouverture de la boutique, d'autres que ma mère les appelle à la porte de notre salle d'eau où elle donnait les premiers soins sur les plaies dues aux machettes, elle soignait aussi les maux de ventre et tous les petits bobos... Un jour, elle accoucha la femme de Touré, le boutiquier et mis au monde des jumeaux.
Et moi, malgré mes six ans, je me souviens bien de la couleur jaune du terre plein de la plantation, du vert sombre et luisant des arbres entourant la maison, des baies de caféier et des fèves de cacao séchant au soleil se couchant sur les cases des manœuvres, des hangars brûlants et poussiéreux, de la marmite de riz fumant sous l'estanco qui servait de cuisine à Touré, de ces journées trop courtes où mon jeu préféré consistait à promener Bamboula, mon singe et à attendre la nuit tombée que Maman nous chante, assises sur les marches éclairées par la lune, face au jardin plongé dans le noir: Le loup, la biche et le chevalier, Une chanson douce, La chasse aux papillons, Le noël des petits santons, Douce France, Bonsoir madame la lune. Le pays d'ici et celui de là-bas, l'enfance d'ailleurs, celle des flamboyants.
Texte et images de caroline_8