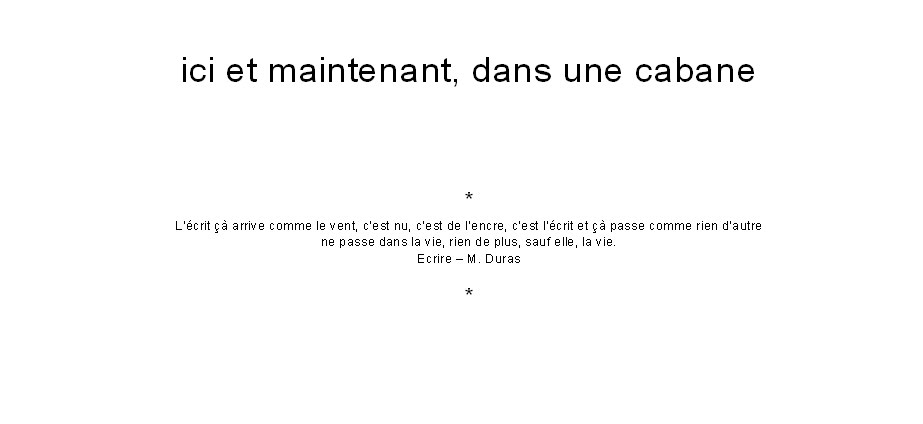En juin 1952, ma mère M-A et moi, après un séjour de six mois en France, rejoignons mon père F. basé à Dimbokro, en partance pour Daloa.
C'est en DC4, avion de la TAI (transports aériens intercontinentaux) que nous quittons Paris, en faisant escale à Casablanca (Maroc), à Bamako (Mali), pour Abidjan (Côte d'Ivoire). Voyage sonore et vibrant, pendant lequel j'ai dormi dans un "filet" sorte de petit hamac de voyage que l'on accroche dans les avions ou les trains.
C'est en DC4, avion de la TAI (transports aériens intercontinentaux) que nous quittons Paris, en faisant escale à Casablanca (Maroc), à Bamako (Mali), pour Abidjan (Côte d'Ivoire). Voyage sonore et vibrant, pendant lequel j'ai dormi dans un "filet" sorte de petit hamac de voyage que l'on accroche dans les avions ou les trains.

A Abidjan, un collègue de F. de la maison Perinaud (petit propriétaire de comptoirs en AOF), nous amène à la gare et, avec une cantine et un petit bagage, nous prenons un vieux train à plate-forme arrière, aux fenêtres sans vitre, mais grillagées, et M-A, s'assoit sur une banquette de bois, à côté d'un Père Blanc (missionnaire français habillé de blanc).
La nuit tombe rapidement et dans le noir complet, elle apprend qu'il y a eu un déraillement sur la voie, que le train n'ira pas plus loin qu'Agboville et se souvenant que, dans cette ville, il s'y trouve une boutique de la maison Perinaud, elle descend avec la cantine, son bagage et moi à Agboville; nous passons la nuit dans la "chambre de passage" pour reprendre le lendemain, cette fois-ci une micheline.
La nuit tombe rapidement et dans le noir complet, elle apprend qu'il y a eu un déraillement sur la voie, que le train n'ira pas plus loin qu'Agboville et se souvenant que, dans cette ville, il s'y trouve une boutique de la maison Perinaud, elle descend avec la cantine, son bagage et moi à Agboville; nous passons la nuit dans la "chambre de passage" pour reprendre le lendemain, cette fois-ci une micheline.
Une demi-heure après le départ, le train s'arrête: le contrôleur est tombé par la portière... marche arrière pour retrouver le contrôleur bien sonné et de nouveau, marche arrière jusqu'à Agboville. Le contrôleur est amené à l'hôpital; la micheline repart, la nuit tombe et le voyage touche à sa fin; à 5 km de Dimbokro, un choc, le train stoppe: il a écrasé un buffle. Pour s'en dégager, le train avance, recule et avance pour enfin, libéré de son obstacle, repartir et arriver à destination.

J'ai six mois et cela fait six mois, que mes parents ne se sont vus... le voyage, pour les retrouvailles, a duré trois jours. Le lendemain, Papa, Maman et moi prenons la route avec le "pick-up" pour Daloa où nous résiderons trois mois.
Texte et image de caroline_8
Texte et image de caroline_8